One English-speaking woman says she did not have access to an intepreter during the birth of her first child, which left her hospitalized for a week. She says she does not feel as if staff made sure she understood what was going on.
Accès aux interprètes pour les femmes immigrantes lors des accouchements : Un enjeu critique pour le système de santé de Québec
L’accès aux services d’interprétation dans les hôpitaux de Québec est devenu un sujet de préoccupation majeur, en particulier pour les femmes immigrantes lors des accouchements. Une organisation dédiée à l’accompagnement périnatal pour ces femmes a récemment soulevé des inquiétudes quant au manque d’interprètes disponibles durant les accouchements, ce qui pourrait compromettre le consentement éclairé des patientes et leur bien-être.
L’importance du consentement éclairé en milieu hospitalier
Le consentement éclairé est un principe fondamental du soin médical, permettant aux patients de comprendre les procédures médicales qu’ils sont sur le point de recevoir et d’y consentir en toute connaissance de cause. Selon Marielle M’Bangha, directrice du Service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de Québec, ce principe est parfois mis à mal faute de services d’interprétation systématiques au CHU de Québec-Université Laval. L’organisation plaide pour que les formulaires de consentement et autres documents essentiels soient traduits et facilement accessibles dans plusieurs langues, garantissant ainsi que les patientes peuvent faire des choix informés concernant leur santé.
Les défis d’une offre linguistique limitée
La réalité linguistique complexe de la province de Québec pose des défis particuliers. Bien que les francophones soient majoritaires, un nombre significatif de résidents non francophones, notamment hispanophones et anglophones, nécessitent des services adaptés. En effet, des statistiques montrent que 35% des demandes d’interprètes sont pour l’espagnol et seulement 0,86% pour l’anglais, malgré une population importante d’anglophones dans la région. Cette déconnexion entre l’offre et les besoins réels indique un besoin urgent de réformes.
Les conséquences d’une mauvaise communication lors des soins
L’absence d’interprétation adéquate peut avoir des conséquences graves lors des soins critiques, comme en témoigne le cas de « Mary », une mère immigrante ayant vécu un accouchement difficile sans interprète. Faute de pouvoir comprendre pleinement les formulaires et les consignes médicales exclusivement en français, son expérience hospitalière s’est révélée traumatisante. Mary représente une des nombreuses femmes qui, en l’absence de traduction, risquent de subir des soins sans avoir toute l’information nécessaire, un problème que le CHU de Québec doit adresser pour éviter de potentielles répercussions légales et éthiques.
Projections et perspectives d’amélioration
Observant l’augmentation du besoin d’interprètes, qui a doublé en cinq ans selon Santé Québec, des solutions doivent être explorées. Premièrement, renforcer les ressources allouées à la traduction et à l’interprétation pourrait être une priorité. L’adoption de technologies avancées de traduction ou l’extension des partenariats avec des prestataires privés sont des pistes envisageables. De plus, sensibiliser le personnel hospitalier aux droits linguistiques des patients et renforcer les formations culturelles peuvent aider à combler les lacunes actuelles.
La dimension juridique et économique
Il est crucial de reconnaître les implications juridiques de ne pas assurer des services linguistiques adéquats dans les services de santé. Le non-respect des droits des patients à des soins dans leur langue pourrait entraîner des plaintes et des litiges coûteux. D’un point de vue économique, offrir un accès linguistique adapté pourrait réduire les coûts à long terme en diminuant les erreurs médicales et les complications dues à une mauvaise compréhension des soins post-opératoires.
Vers un changement systémique
L’exemple de Mary et les revendications des organisations pour femmes immigrantes soulignent la nécessité d’un changement systémique. Les gouvernements et les institutions de soins de santé doivent collaborer pour prioriser l’inclusivité linguistique. À long terme, un système qui répond proactivement aux besoins diversifiés des patientes améliorera non seulement la qualité des soins mais renforcera également la confiance des communautés minoritaires envers le système de santé.
Regard vers l’avenir
Alors que les demandes pour une meilleure accessibilité linguistique dans le système de santé de Québec augmentent, il devient impératif d’adopter des stratégies globales qui intègrent la diversité culturelle de la population. Cela inclut non seulement l’augmentation des services d’interprétation, mais aussi une refonte des procédures administratives pour qu’elles soient plus inclusives. Un tel engagement peut servir de modèle à d’autres provinces canadiennes où des défis similaires existent. En outre, sur la scène internationale, le Québec pourrait se positionner comme un exemple de meilleures pratiques en matière de soins de santé centrés sur le patient dans un contexte multiculturel.
En résumé, pour faire face à ces défis complexes, une approche multi-niveaux est requise, impliquant des politiques robustes, des investissements technologiques et une sensibilisation accrue auprès du personnel de santé. L’engagement collectif peut non seulement améliorer les résultats en matière de santé, mais également promouvoir l’intégration sociale et culturelle à long terme.
Source : Cbc
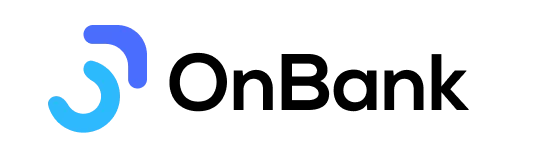
Laisser un commentaire